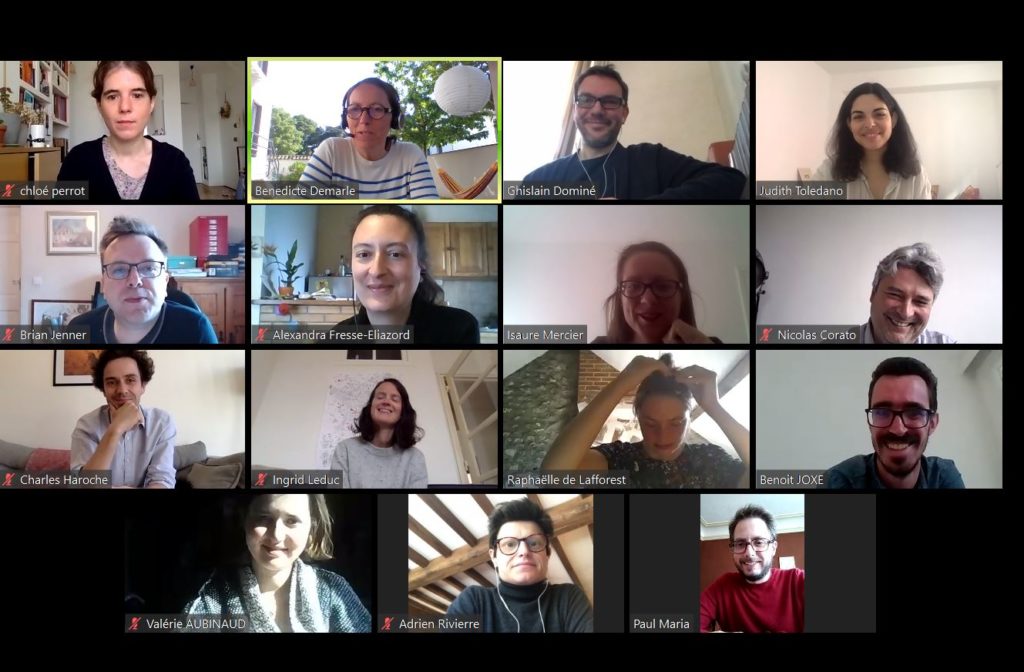Voilà la question -unique, sur le papier- avec laquelle nous étions entrés en réunion à 8h30, vendredi 24, pour le second café confiné de la Guilde des plumes.
Une heure et demie plus tard, à défaut d’avoir complétement répondu à la question, nous en sortions avec une demi-douzaine d’autres : sur les fonctions du discours en période de crise, les nouvelles attentes -individuelles et collectives- et les nouvelles contraintes ; sur la manière dont le dirigeant doit se positionner, au sens propre comme au figuré ; sur la manière dont la plume peut traduire ces inquiétudes -les siennes propres, celles de son orateur, celles du public ; sur l’art d’annoncer les mauvaises nouvelles ; sur l’impuissance du politique face à la fortuna, et sur la nécessité d’admettre cette impuissance.
Probablement une fatalité, lorsqu’on échange avec un psy, de sortir avec plus de questions que de réponses. Mais lorsque ces questions nouvelles sont aussi riches, aussi ouvertes, le temps de la discussion n’est probablement pas perdu, et les réponses émergent déjà, en creux.
La question initiale avait été posée à l’issue du premier café confiné, la semaine précédente. L’idée était alors née de demander à une psychanalyste, Judith Toledano-Weinberg, de nous éclairer sur la part intime des inquiétudes que le discours serait censé venir soigner, et sur la perception de ce discours par les individus. En contrepoint, plus « macro » et historique, Paul Maria, qui avait tenu il y a dix ans la plume d’un Ministre de l’Economie en pleine crise des dettes souveraines, est venu partager ses réflexions sur les parallèles et différences avec la crise actuelle. De leurs témoignages est née une discussion très riche entre nous, qu’une heure trente n’aura pas suffi à clore.
Crise d’hier, crise d’aujourd’hui
Entre 2010 et 2020, beaucoup de similarités : un épicentre hors de France, des doutes sur le fait d’être touché, une incapacité à anticiper l’onde de choc, sa magnitude, sa vitesse de propagation, le passage à un gouvernement de techniciens -banquiers centraux hier, médecins aujourd’hui- et l’effacement du politique, l’enrichissement du vocabulaire collectif -créances toxiques, hydroxychloroquine-, une situation critique mais invisible, avec une pédagogie de la crise à mettre en œuvre. Pour certains, aussi, le même sentiment de culpabilité, le même retour à la réalité.
Deux différences de taille, en revanche : les acteurs en jeu, et la temporalité. Il y a dix ans, le pouvoir politique ne s’adressait pas qu’aux citoyens. Il s’adressait aussi, voire surtout, à une pluralité d’acteurs aux intérêts divergents : partenaires européens, Parlement (des budgets rectificatifs tous les 3 mois), aux agences de notation. Il y a dix ans, la crise avait mis deux ans à se diffuser au monde, aux collectivités locales, aux individus -notamment à travers Dexia. Elle aura mis deux mois cette année, réduisant d’autant le temps de la pédagogie d’entrée en crise, et compliquant en retour celle de sortie de crise.
Dans les deux cas, néanmoins, la même difficulté de trouver le bon positionnement, par rapport à des attentes qui évoluent.
Dans un premier temps – celui de la sidération- le discours politique se découvre une fonction inédite : informer, d’abord, face à l’incertitude et aux informations parcellaires et contradictoires, face aux nouveaux prophètes et aux experts autoproclamés. Devant la vague qui arrive, le public attend d’abord des repères sur qui croire, sur la gravité de la crise, le moment où on en est, ce qui arrivera demain.
Le discours se doit donc d’être le plus factuel possible, parfois jusqu’à l’aridité technique, pour dissiper tout sentiment de rétention d’information, être constant, transparent sur les risques encourus, les scenari possibles, mêmes les plus sombres. S’abstenir de promettre trop tôt une issue favorable, aider le public à se projeter dans la crise et dans l’après-crise à travers l’effort que cela demandera. La comparaison, parfois absurde, la métaphore et l’emphase peuvent être utiles pour éveiller les consciences, quand certains doutent encore de la réalité de la menace -à condition de viser juste. Mais dès que la crise est là, mieux vaut éviter l’emphase, mesurer la longueur et la fréquence des interventions, car l’excès engendre le doute.
Le second temps, c’est celui de l’orientation collective. Le public cherche alors à savoir qui dirige, comment se prend la décision, ce qui est proposé, la conviction et l’engagement des dirigeants, la proportionnalité, la nécessité et le réalisme des mesures -le dilemme de la Grèce hier, aujourd’hui l’arbitrage entre protection des ainés et conséquences économiques. Avec la difficulté de trouver le bon tempo des annonces, le bon positionnement : difficile d’annoncer une extension de la période de confinement pour certaines catégories alors que le discours général cherche à rassurer sur la perspective de sortir sereinement.
Et la plume ? La plume, dans ces moments, doit à la fois savoir résister à la tentation du langage technocratique, rappeler à son orateur quel public il a face à lui, et tenter de prendre de la hauteur, sortir de l’urgence quotidienne pour communiquer sur la sortie du tunnel. Tout en ayant bien conscience que, plus que jamais, il n’a pas prise sur une part plus subjective du discours, qui repose sur l’engagement personnel de l’orateur et qui est au cœur de tout en temps de crise. Conscience aussi que d’autres peuvent, par leur aura, leur charisme, leur parole parfois prophétique, avoir confisqué une part du capital symbolique du dirigeant.
La « mère suffisamment bonne »
Le parallèle avec l’analyste est ici intéressant. Dans ces moments de crise, de déréalisation, où tous les rituels, tous les semblants sautent, même les plus protecteurs, lui aussi doit parfois sortir de sa neutralité. Non pas forcément faire part de ses propres doutes au patient, mais ne pas nier la dimension collective du traumatisme.
Il en est de même pour l’orateur, qui doit savoir laisser la porte ouverte à un besoin de creuser plus profondément notre rapport au monde, à l’avenir. Sachant que cette projection dans l’avenir, protectrice ou rassurante pour certains, sera angoissante pour d’autres. Car elle révèle forcément une faille qui ne pourra pas être comblée, et que l’après-crise fera peut-être plus de victimes que la crise elle-même. Comment, dès lors, être cette « mère suffisamment bonne », ni défaillante ni excessivement protectrice ?
Dans nos échanges, revint aussi l’idée qu’une partie de ce lien, de cet engagement personnel du dirigeant, va bien au-delà du langage, que les mots trouvent leurs limites, et qu’il passe par le corps, la posture, le regard même. Que la plume doit peut-être alors s’effacer, pour laisser parler l’orateur lui-même, qui saura parfois mieux traduire ses convictions profondes, son empathie.
Hasard des choses, la veille de notre réunion, Andrew Cuomo, Gouverneur de l’Etat de New York, était interrogé par Trevor Noah sur sa manière très personnelle, sans filtre, d’annoncer très tôt à ses administrés les menaces qui pesaient sur eux, l’absolue nécessité du confinement et la probabilité de décès nombreux -donc de faire tout sauf rassurer. Voilà une partie de sa réponse, inspirante et ô combien en lien avec nos réflexions :
« Je n’ai pas les moyens de contraindre par la force dix-neuf millions de personnes à rester chez eux. Notre faculté d’avoir un plan dépendait donc intégralement du fait que les New Yorkais y souscrivent. Or ils sont intelligents, cyniques, et s’ils ne vous croient pas, si vous n’avez pas développé vos arguments, si vous n’avez pas présenté les faits, ils ne vont pas le faire. […]
Ce n’est pas mon boulot de ne pas dire la vérité [V.O. : « I’m not in the business of not telling the truth »], de manipuler, ou « Je vais seulement vous dire ce que vous pouvez gérer, car je m’inquiète de ce que vous pouvez réellement intégrer ». Non. Je ne suis pas là pour filtrer, pour manipuler. Voilà l’information. Voilà les faits. Vous savez tout ce que je sais. Et de la manière dont je le sais. Sans pommade. […]
Une part de l’information était personnelle, car c’est un traumatisme pour toute une génération. C’est personnel, donc j’ai essayé de communiquer comment je le ressentais personnellement, mes peurs, mon anxiété afin de dire : « Vous n’êtes pas seuls, tout le monde ressent cela, et je le ressens aussi ».
La seule différence, c’est que je dois faire face au nombre de morts dans l’Etat. […] Je ne crois pas que nous ayons perdu qui que ce soit parce que nous n’avions pas de lit, pas de docteurs ou d’infirmières. Mais nous avons quand même perdu quinze mille personnes. Je suis le Gouverneur et je me tiens toujours pour responsable. Et je me dis toujours : « Y a-t-il quoique ce soit que nous pourrions faire de plus en ce moment ? ». C’est un fardeau très lourd pour moi. »
J’ignore si Andrew Cuomo est la « mère suffisamment bonne » dont nous rêvons tous, mais nous sommes heureux d’avoir les mêmes réflexions, et serions ravis de l’accueillir pour un prochain café. Si quelqu’un a son numéro…