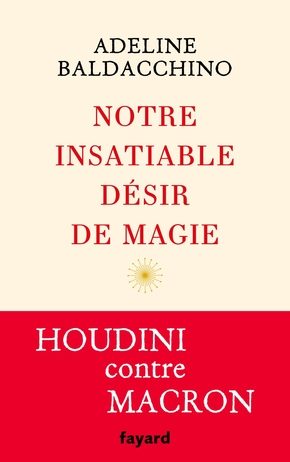Un livre dont le déclic a été pour l’auteure le mouvement des Gilets Jaunes, avec des références multiples trouvées chez les penseurs hétérodoxes, les écrivains et les poètes. Car Adeline Baldacchino est autant poète qu’essayiste et pour elle, la pensée politique s’est atrophiée à ne s’inspirer que des livres d’économie (néolibérale).
Changer la vie
Au cœur de la crise sanitaire, le confinement m’offre des plages de temps idéales pour lire, réfléchir… Pas vous ? Ok, soyons honnête, la vie en confinement ne nous pourvoie pas forcément de cette liberté : il y a l’école à la maison (argh), les outils de visio-conférence à apprivoiser pour continuer de travailler (idem), la cuisine et autres activités auxquelles on arrivait à échapper lorsque l’on vivait « à l’extérieur » (et que les enfants étaient occupés). Et se retrouver chez soi, branché malgré soi sur l’actualité, laisse aussi infuser l’inquiétude sur le monde à venir (à court terme comme à long terme).
Après la sidération des premiers jours, mes neurones avaient un peu de mal à articuler une pensée cohérente. Or j’avais acheté ce livre juste avant le confinement. Paru chez Fayard en novembre 2019, Notre insatiable désir de magie, d’Adeline Baldacchino promettait de me sortir de la pensée dominante, de me donner une grille de lecture sur le monde « juste avant »… pour, peut-être, commencer à penser le monde « d’après ».
Dès l’introduction, l’auteure donne le ton en citant Arthur Rimbaud (ça aurait pu être Jean-Jacques Goldmann…) : « changer la vie ». C’est l’espoir que nous pouvons mettre en la politique. C’est peut-être même une de ses missions, une mission que se donnent ceux qui s’engage dans ces carrières.
La livre n’est d’ailleurs pas une charge cinglante contre le Président en exercice, quoique la jaquette du livre annonce le match « Houdini contre Macron ». On sent chez l’auteure presqu’une tendresse pour celui qu’elle nomme « le dernier des rois (des énarques) ». Elle y a cru, à ce jeune magicien. Elle croit même en sa bonne foi, lorsqu’il entend faire bouger les lignes…
Mais elle n’y croit plus pour construire un monde meilleur. Elle n’a d’ailleurs pas de favori pour 2022 ou 2027, et dans sa conclusion (attention spoiler), elle appelle plutôt de ses vœux l’arrivée sur la scène publique, et politique, d’un collectif. Avec des personnes qui auraient lu, entre autres, les livres qu’elle donne en références dans sa bibliographie, et que je n’aurais pas forcément trouvé dans la bibliothèque de Sciences-Po.
Car pour ceux qui sortent du sérail, et qui ont, comme elle, suivi un parcours « classique » « Sciences Po-ENA, le formatage a rogné les ailes, il a plombé même les envies d’envol pour voir plus loin, il a mis des œillères.
Is there an Alternative ?
La charge que porte Adeline Baldacchino, c’est contre TINA. Qui est TINA ? C’est la fameuse sentence « There Is No Alternative » qui est en sous-texte de bien des prises de parole, et même d’un faux « grand débat » où les alternatives proposées entraient dans le cadre d’une seule pensée, la pensée néolibérale, et d’un seul impératif : la réduction des dépenses publiques. Avec obligation de « performance », « d’efficacité ». (Et l’application de ces principes sur le système de santé laisse à voir ses conséquences aujourd’hui)
Or, un Etat n’est pas une entreprise, il n’a pas le même horizon temporel, il n’a pas le même rapport à la monnaie… Pour l’auteure, « la dépense publique n’est ni bonne ni mauvaise par définition : elle n’est utile, et donc légitime, qu’à condition de servir des objectifs qui le sont eux-mêmes. » S’il est sain de lutter contre les gaspillages, faire de la réduction des dépenses publiques un objectif en soi qui conditionne tous les choix relève de l’absurde.
L’auteure donne de multiples chiffres, pour étayer son raisonnement, dont ceux concernant les inégalités en France, mais aussi, dans d’autres pays européens, ceux de l’impact sur la santé de politiques d’austérité. Elle cite ici le livre de David Stuckler et Sanja Basu Quand l’austérité tue. Ils y affirment, exemples à l’appui (Grèce versus Islande) que « les dépenses de santé publique permettent non seulement de sauver des vies mais aussi… de diminuer la dette publique, parce qu’un peuple en meilleur santé consomme plus qu’un pays menacé par des coupes claires. » Et l’auteure ajoute « l’assurance chômage ne leste pas les comptes publics, elle évite que les chômeurs cessent de dépenser, puis de s’alimenter, avant de tomber malade… »
Réflexion qui résonne singulièrement à l’heure où plus d’un tiers des salariés du secteur privé sont au chômage partiel.
Pour une radicalité joyeuse
Le titre évoque la magie… Il ne s’agit pas ici de faire appel aux fées, aux Korrigans ou autres sorciers. Les magiciens qui servent de modèlent à l’auteure sont les prestidigitateurs : ceux qui étonnent, par leur habilité à nous faire rêver, ceux qui inventent des façons de se sortir de situations semblant inextricables. Et ceux qui ne rechignent pas à transmettre, à donner, à ceux qui le veulent, leurs secrets.
L’idéal reste démocratique, le peuple, dans la diversité de ce que cette notion recouvre, doit être mieux considéré, et l’on sent dans la période à quel point ce besoin est patent quand les infirmiers et tout le personnel de santé sont applaudis sur les balcons à 20h, quand les familles accrochent des mots de remerciements sur leurs poubelles pour les éboueurs.
Le principe d’Houdini (magicien capable de s’échapper de toutes les situations, comme d’une boite scellée mise dans un bassin d’eau – métaphore ?) correspond au fait que « chacun peut agir avec ses moyens, dans son champ de compétence et de désir. »
S’il y a besoin d’experts, leur rôle est à interroger quand ce sont eux qui fixent les objectifs : « C’est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal, même si le cordonnier est l’expert qui est le meilleur juge pour savoir comment y remédier […]. Une classe d’experts est inévitablement si éloignée de l’intérêt commun qu’elle devient nécessairement une classe avec des intérêts particuliers et un savoir privé, ce qui, sur des matières qui concernent la société, revient à un non-savoir. » (John Dewey)
Le mot a été lâché : désir. Rendre le politique désirable (le politique, au sens global de l’organisation de la vie en société). Pour cela, il doit faire rêver. L’abstention et les sondages d’opinion nous montre bien que ce n’est pas le cas depuis des décennies, pour ce qui concerne la classe politique…
L’auteure rêve de sa plume d’un système décidant de « faire du ministère des Finances un simple secrétariat technique et des ministères de la Santé, de l’Education et de la Culture des priorités absolues. » Et d’une ouverture du champ des possibles, qui suppose de « sortir du cadre » (d’où le rôle de la culture), et de faire confiance à ce qui est perçu comme « le bas », au niveau de l’expérimentation sociale et des plus petits échelons institutionnels.
Au-delà du désir, il s’agit tout simplement de faire appel aux forces de vie « ou de l’amour, – précise l’auteure – qui est l’inverse de la haine. » Dans le moment que nous traversons, particulièrement anxiogène, le message est clair : combattre les peurs est le prochain défi.
Car, et je conclurai par cette citation (c’est moi qui cite, l’auteure a d’autres références) :
« La peur est le chemin vers le côté obscur : la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine… mène à la souffrance. » (Maître Yoda)
Ou à la violence.
Bon confinement.